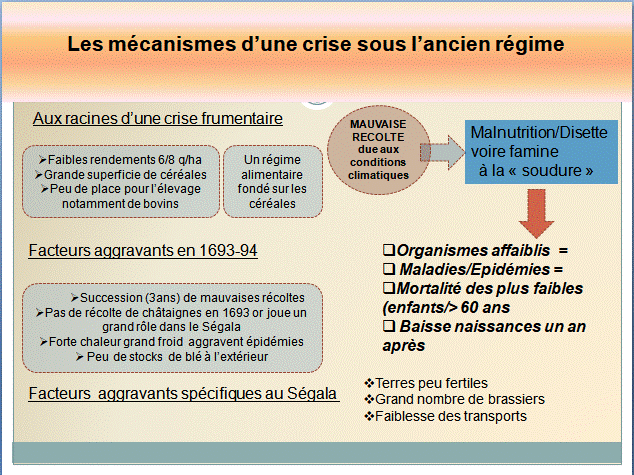
Le service éducatif des archives départementales du Tarn a publié un document (Archives Départementales du Tarn, 6 E 10 /76). qui peut éclairer la situation locale. Il s’agit d’une note sur les hivers rigoureux des années 1693 et 1694 de François Delaval, fils de notaire et notaire royal à Pampelonne,(son frère est curé à Lunaguet) ; il est aussi docteur en médecine. Rédigée trois ans après la crise, elle a le mérite d’être un résumé très synthétique des malheurs du moment.
« Il est à remarquer à la postérité que l’année mil six cens nonante trois, nonante quatre, ont este des annés acablés de fléaux et de malheurs, la guerre estant extraordinairement eschauffée dans toute l’Europe, les maladies populaires si grandes dans notre royaume qu’il mourut une troisième partie du peuple, presque dans toutes les parroisses, et une disette aussi tellement grande que la plus grande partie mourut de faim, estant en obligation de brouter les herbes, manger les orties et aussi plantes des qu’elles commencèrent à sortir de terre dans le printemps. Le seigle se vendit en ce pais 24 livres le cestier Le fromant 28 livres le cestier Le millet gros et les grosses feves 50 l[ivre] la mesure. Et A Albi du vin du pais iusques à vint cinq escus. Les souches des vinhes toutes mortes par la Vigur des deux hivers de 1694 et 1693 Et l’année 1693 point de chastaignes Dans laquelle années les fléaux commencèrent. »
La livre : monnaie de compte divisée en 20 sols et 240 deniers. Un brassier gagne environ dix sols par jour (sans nourriture). Avec deux sols il peut s'acheter un litre de vin ou un fromage de 250 gr (poids d'un camembert) ou une demi-douzaine d'œufs ou bien encore un pain de 500 gr ou 250 gr de mouton mais il ne pourra pas acheter un litre d'huile d'olive qui coûte 12 sols (en 1710). De nombreux exemples de prix dans Roger Faure " Economie, revenus et prix au XVIII ème siècle en Forez », 2011.
Le setier (cestier), mesure de capacité qui vaut à Albi 1,206 hl. Les unités de mesure varient assez fortement selon les régions. Un setier de grains ensemence une surface d’une sétérée (un quart à un demi-hectare selon les endroits). A Paris, le setier vaut 1,561 hl et pèse pour le blé 240 livres (117,5 kg) à la densité de 0,75.
La mort est ici majoritairement (« la plus grande partie ») attribuée à la faim et se manifeste dès le printemps, en général vers le mois de mai, au fameux moment de la « soudure », quand les maigres réserves, pourtant sûrement économisées, voire drastiquement rationnées, sont épuisées et que la nouvelle récolte est encore loin. On « broute les herbes» : Marcel Lachiver (Les années de misère … ouv. cité), plutôt que les « orties » met en avant les fougères dont les racines furent l’un des ersatz employé pour remplacer le pain, qu’il fut de blé ou de seigle. Gageons qu’il y eut bien d’autres recettes (farine de glands …). Peut-être efficace pour calmer la faim, la consommation des « herbes et plantes» débouche sur « les maladies populaires » que notre auteur, pourtant médecin, ne détaille pas. A ce sujet, les indications fournies par les textes contemporains sont tout aussi floues : fièvres putrides, malignes, pestilentes, vermineuses, pernicieuses, pourpres … On peut tout imaginer. A l’été 1693, selon Marcel Lachiver, il semblerait que ce soit la fièvre typhoïde la responsable des pics de mortalité mais la dysenterie (les « flux de ventre »comme on dit) est une coupable tout aussi plausible ou encore, à l’automne, « le mal des ardents » celui du seigle ergoté (épis contaminés par un champignon en cas de fortes pluies). Impossible à vérifier, mais finalement peu importe, ce qui est certain, c’est que les épidémies sont les filles de la disette et qu’elles parachèvent son ouvrage. Si on meurt peut-être rarement de faim, au sens strict du terme, le point de départ des décès est incontestablement la crise de subsistance. Les discussions de spécialistes, - tournant parfois aux vaines querelles - qui cherchent à départager les rôles respectifs de la faim et de la maladie dans les décès devraient conclure que les deux sont étroitement liées : l’épidémie agit car elle trouve un terreau fertile pour se développer, celui d’organismes sous-nutris et épuisés par la disette.
Évidemment, le manque de céréales produit la hausse de leur prix, bien soulignée par notre docteur-notaire. Cette inflation concerne avant tout les urbains et tout particulièrement leurs pauvres qui, au contraire de ceux des campagnes, n’ont aucun stock de grains, même minime, à leur disposition. Les paysans du Ségala, globalement pauvres, et tout particulièrement les brassiers ne sont pas en mesure eux non plus de se procurer les très rares grains en circulation.
Dans le mécanisme classique des crises d’ancien régime, les pics de mortalité sont accompagnés d’un effondrement des naissances. Celui-ci est repérable dans la paroisse de Notre Dame des Infournats, dès 1692, avec seulement trois naissances, alors que la moyenne est de six pour la période 1608-1699 et il se poursuit en 1694. Vient ensuite, habituellement, un « boom » de reprise. Il est ici assez tardif : il faut attendre 1698 pour qu’il se manifeste nettement : dix naissances. Les mariages, classiquement, connaissent aussi une « flambée post-crise ». Mais cette fois, ce n’est pas le cas et ce n’est qu’en 1705 que le nombre de mariages dépassera (et faiblement) la moyenne séculaire.
A Naucelle, même effondrement des naissances : 19 en 1693, 10 en 1694, pour une moyenne de 33,5 (1675-1700) et il faut attendre 1700 pour une véritable reprise (40 baptêmes). Les mariages, eux aussi, ont un redécollage tardif : 1702 avec 15 mariages (double de la moyenne). Conclusion : l’énorme masse de décès semble avoir entamé les dynamiques de reprise démographique habituellement constatées lors des mortalités « classiques » d’ancien régime (hausse de la natalité et de la nuptialité juste après la crise).
Au total, le tableau est sinistre : décès massifs, naissances réduites, des reprises tardives pour la nuptialité comme pour la natalité. Il va sans dire que les populations de la paroisse des Infornats et de ses voisines, ou celles de Naucelle et sans doute de beaucoup d’autres communautés dans la région, sont à la fin des siècles, démographiquement exsangues et menacées dans l’immédiat, de non-renouvellement.
Le trio infernal du froid, des hyper pluies et de l’échaudage a généré, en cumulant ses effets, une catastrophe, car le substrat économique et social s’y prêtait. Faisons la revue des éléments du « terreau agricole » qui, comme l’écrit Emmanuel Le Roy Ladurie font que les famines sont « suractivées ».
Premier élément, le faible rendement des céréales. Michel Morineau , en s’appuyant sur les chiffres fournis par Vauban dans son « projet d’une Dîme Royale » (publié en 1707) indique pour le blé un rendement minimum de 4.5 grains récoltés pour 1 semé. Dit autrement, pour un hectare, une récolte d’environ 400 à 600 kg de blé (4 à 6 quintaux l’hectare) car la masse varie en fonction du poids spécifique qui change selon la qualité du grain. Avec cette récolte minimum (dans les bonnes terres, on fait au moins le double), un paysan, pour nourrir une famille de quatre personnes - en tenant compte qu’il garde des grains pour semer (il faut 130 à 170 kg pour ensemencer un hectare en seigle) - doit posséder environ 3/3.5 hectares emblavés en céréales. Le "minimum d’indépendance" est pour Emmanuel Leroy-Ladurie de 5 ha en montagne (Histoire de la France rurale, T.2, p 418). Nos calculs rejoignent les siens. Ils sont fondés sur une solide ration (800 grammes par jour, celle indiquée par Vauban) de pain « blanc » de blé l’aliment de base de la population de la France de l’époque, vaut aussi pour le pain « noir » de seigle, celui que consomment nos paysans du Ségala. Nous n’avons que peu de données, pour cette période, sur le rendement des récoltes locales mais les terres acides du Ségala, qui ne sont pas encore amendées par la chaux, n’ont pas une réputation de grande fertilité … et le minimum de Vauban est peut être encore trop élevé. E. Le Roy Ladurie mentionne pour le Languedoc une moyenne de 4 grains pour un, ce qui est sans doute proche de la réalité moyenne du Ségala . Bref, la production locale est, au mieux, « sur la corde raide » et l’approvisionnement, un souci constant, d’autant plus que les paysans de la paroisse sont majoritairement des « brassiers » qui n’ont guère de terres et qui, comme leur nom l’indique, vivent de leurs bras. Sur le siècle, on peut en repérer dix-huit dans les registres paroissiaux de Notre Dame des Infornats, alors qu’il n’y a que trois « laboureurs ». Possédaient-ils les 3.5 hectares fatidiques ? Peu probable : au XIXe siècle, bon nombre de paysans des Infournats (nom du lieu à cette date : la transformation du o en ou est classique) ont moins d’un hectare. Même s’il est historiquement délicat d’effectuer une démarche régressive, on peut légitimement penser que leurs ancêtres n’étaient guère mieux lotis. Faible rendement, micro propriété : les brassiers locaux n’ont pas, même en temps normal, les moyens de l’autosuffisance en grains. Ils peuvent (pas tous) compter sur le complément alimentaire des châtaignes mais cela ne suffit pas et il leur faut, par leur travail extérieur, dégager des moyens pour se procurer le complément qui leur manque. Inutile de dire qu’en mauvaise année la situation tourne vite à la catastrophe … d’autant plus que : « Et l’année 1693 point de chastaignes » !
Le deuxième facteur est, non plus le rendement de la terre, mais celui du travail. Marcel Lachiver estime qu’en 1700, un homme entretient 3 à 4 ha, c'est-à-dire - de fait - ce qui lui est nécessaire pour son auto-approvisionnement ! Pour labourer, à vrai dire - sur les versants en terrasses - le terme bêcher (avec le « palabès » bêche à deux dents ou la houe, « lo bigos ») serait plus approprié et faire les semailles de nos 3,5 hectares, les paysans doivent disposer, à l’automne, d’une bonne quinzaine de jours (plus sur les versants), sans trop de perturbations météorologiques. Ce n’est évidemment pas toujours le cas. En outre, en dehors de l’orge et de l’avoine, mais encore faut-il disposer de semences, il n’y a pas de cultures de printemps de substitution. Pour faire la moisson c'est-à-dire, faucher (à la faucille), lier les gerbes, les ramasser et les rentrer au sec, un mois de labeur collectif est sans doute nécessaire, mobilisant l’ensemble de la paroisse (hommes femmes et enfants sont à l’ouvrage). Un été « pourri » avec des beaux jours éparpillés devient vite dramatique.
Avec 100 à 200 kg, voire plus, ramassés par jour et par personne, les châtaignes n’ont pas le temps de pourrir dans les sous-bois et, au contraire des céréales, la récolte est assurée, à condition bien sûr que la fructification se soit bien déroulée. « Quont y o pla de costognos, lou ségolis son fiers » (quand il y beaucoup de châtaignes, les ségalis sont contents), ce proverbe aveyronnais montre bien que ce complément nutritif qui évitait, ou limitait fortement, pendant un long moment la consommation de pain a joué dans toutes les zones de castanéiculture, un rôle sans aucun doute considérable dans l'évitement de bon nombre de disettes. Quelle place exacte la châtaigne tenait dans le régime alimentaire des paysans du Ségala ? En l’absence de documents fiables (en tout cas nous n’en avons pas trouvé) impossible de le dire exactement. Restent les spéculations : il est probable que de fin octobre à avril (grâce à sa dessiccation), d’abord fraîche, puis grillée ou bouillie, on consomme la châtaigne quotidiennement quand la récolte le permet (une fois par jour et peut-être plus ?).
Le troisième handicap structurel est celui des transports. Le réseau des chemins est assurément de piètre qualité et ils sont par mauvais temps véritablement impraticables. De toute façon, la plupart des brassiers ne disposent d’aucuns moyens de transport : au mieux ils ont un mulet et son bât. Seuls les plus riches laboureurs peuvent mobiliser une paire de vaches et une charrette pour aller chercher des grains en cas de distribution par les autorités du diocèse. En effet, celles-ci prirent une série de mesures pour répondre à la crise.