Naître: des enfants en grand nombre mais une fécondité inférieure à la moyenne française
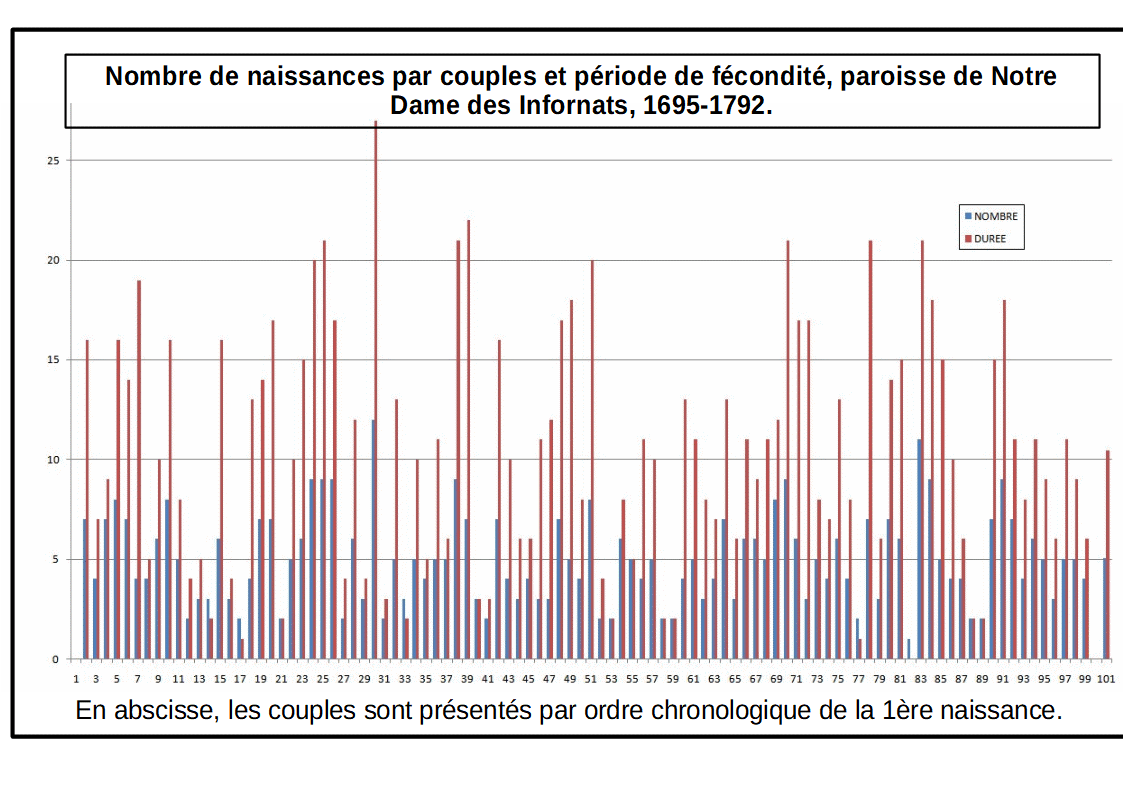
L’analyse des familles n’a pas été réalisée pour le dix-septième siècle, compte tenu des incertitudes des données fournies par les registres paroissiaux, cependant leur lecture nous laisse à penser que « le portrait familial » du dix-huitième vaut aussi probablement pour l’ensemble de la période.
La norme, pour un couple de la paroisse est la mise au monde de cinq enfants (c’est aussi la médiane : il y a autant de couples ayant plus de cinq enfants que de couples en ayant moins de cinq). pendant une période féconde de dix années, soit un enfant environ tous les deux ans. Beaucoup de couples (un tiers du total) ont une période féconde plus longue (15 ans et plus) mais avec un rythme des naissances plus espacé, ce qui fait que les familles ayant généré plus de dix enfants sont marginales (2% du total) alors que celles de trois, ou moins, en représentent presqu’un tiers.
De fait, les couples n’ayant pas beaucoup d’enfants sont minoritairement ceux qui ont un âge très avancé au mariage et majoritairement ceux qui ne durent pas car l’épouse meurt tôt (c’est parfois l’époux, mais très rarement). Lors de l’accouchement en France au XVIIe, un quart des mariages est rompu prématurément de cette façon. Le veuf se remarie rapidement (le plus souvent dans les deux années suivantes), et épouse, la plupart du temps pour ne pas dire toujours, une célibataire en âge de faire des enfants. Il se retrouve ainsi, quelques temps après son remariage, à la tête d’une famille recomposée plus nombreuse. Seuls 15 % des remariages se font entre veufs ( Guy Cabourdin, « Le remariage ». Annales de Démographie Historique, année 1978,) sauf en période de crise démographique où les remariages entre veufs augmentent.
Faute d’avoir pu intégrer ce phénomène dans nos calculs statistiques, la part ci-dessus indiquée des familles nombreuses est sans doute inférieure à la réalité. Malgré ce « biais méthodologique » et la faiblesse de notre échantillon, ces résultats sont toutefois conformes à la fécondité du sud-ouest : plutôt plus basse que dans d’autres régions et ne connaissant pas d’infléchissement au cours de la deuxième moitié du siècle. Cette situation serait pour certains la « conséquence possible d’une pratique particulière de l’allaitement » - en clair le sevrage des enfants à un âge plus avancé que dans le nord de la France et l’absence de la pratique de la mise en nourrice - qui allongerait l’écart entre les naissances, en perturbant le cycle de la fécondation.
Si l’on observe la situation locale (paroisse de Notre Dame des Infornats) l’intervalle intergénésique (Intervalle entre deux naissances successives quel que soit le rang de naissance. Sans contraception ni allaitement cette durée peut être de deux mois seulement. Entre le mariage et la première naissance on parle d’intervalle progénésique) de 1730 à 1789 est d’environ 35 mois, chiffre supérieur à la moyenne citée par Patrice Bourdelais et Jean-Yves Raulot - entre vingt trois et trente mois - pour la période 1650-1720. (« Des risques de la petite enfance à la fin du XVII e siècle. Gestation, allaitement et mortalité », Annales de Démographie Historique , Année 1976 pp. 305-31 (en ligne Persée). L’aménorrhée "post partum " (Ou « aménorrhée de lactation » qui est l’absence de règles pendant l’allaitement. Cette anovulation planifierait [pas tout à fait tout de même] et sans qu’on le veuille, les naissances) moyenne est d’environ quatorze mois (elle est toutefois variable selon les personnes), mais un allaitement prolongé en allonge la durée et recule d’autant la conception qui suit un accouchement. Il est donc fort probable au vu de l’intervalle intergénésique local que l’allaitement était poursuivi plus longtemps que la norme. La faiblesse d’organismes mal nourris peut aussi entrer en ligne de compte pour expliquer cette longueur de l’aménorrhée (« aménorrhée de disette ») On a pu aussi évoquer pour expliquer les longues périodes intergénésiques, l’existence d’un tabou d’abstinence sexuelle pendant l’allaitement,. Mais pourquoi serait-il présent dans le Midi et pas ailleurs ? Hypothèse qui nous semble manquer de preuves.
Ajoutons aussi, pour revenir à la taille plutôt réduite des familles locales, que l’âge tardif au mariage diminue la durée de la période de fécondité. Or pour notre paroisse, dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle, l’âge moyen au mariage est de 27 ans pour les filles et 33 ans pour les garçons, ce qui est supérieur à la moyenne française, surtout pour les hommes (écart de cinq ans contre un an seulement pour les filles).
De nombreux enfants morts prématurément mais plutôt moins qu’ailleurs
Les rôles de la capitation de 1696 détaillent le nombre de personnes dans les ménages, ce qui permet de savoir combien d’enfants y vivent, hélas sans en connaître les âges. La moyenne pour les trois communautés d’entre Viaur et Candour est de trois enfants et non pas de cinq comme pourrait le laisser croire l’analyse rapide des baptêmes, faite ci-dessus. En effet, bien peu de couples ont la chance de conserver en vie les enfants qu’ils ont vu naître. La tranche d’âge des moins de 20 ans représente le tiers des décès de la paroisse. Par ailleurs, le taux de mortalité infantile au sens strict (décès des enfants de moins d’un an rapporté aux naissances, la mortalité « enfantine » comprend les enfants jusqu’à 4 ans) pour la période de 1700 à 1792 à Notre Dame des Infornats est de 105 pour mille (3,7 pour mille actuellement en France …), donc plus d’un quart des enfants n’atteint pas ses 10 ans et un peu plus d’un sur trois ne devient pas adulte.*Cette description, a priori sinistre, cache pourtant une situation moins dramatique que la moyenne et conforme à la situation régionale : « Dans le Sud-Ouest, [aquitain comme toulousain] ce n’est pas seulement la moitié des enfants qui atteint l’âge adulte, mais plutôt les deux tiers. Certains historiens démographes considèrent d’ailleurs que la survie d’un plus grand nombre d’enfants serait l’une des raisons de la fécondité plus faible des couples de cette région et du retard pris dans l’utilisation de la contraception pour réduire la taille des descendances » . (Stéphane Minvielle « Les crises de mortalité dans le sud-ouest aquitain de la fin du XVII e au milieu du xixe siècle » in « Epidémies et crise de mortalité du passé ». Et aussi Agnès Fine-Souriac, « Mortalité infantile et allaitement dans le Sud-Ouest de la France au XIXe siècle ». Annales de Démographie Historique, année 1978, pp. 81-103. En ligne sur le site Persée).
*La moyenne française serait de 1740 à 1789, de 270 pour mille : Jean-Claude Sangoï, « La mortalité infantile en Europe occidentale au XVIIIe siècle » p. 191-210, in « La petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne », s.d Robert Fossier (en ligne OpenEdition Books) citant J. Dupâquier (sous la dir. de) : Histoire de la population française, tome 2, p. 224. La fourchette citée par Lucien Bély, « La France au XVII e …» est de 120 à 360 pour mille (variations selon les régions et les périodes). Bref, les moyennes locales sont en dessous.